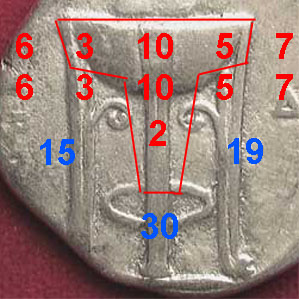CORPUS NOSTRADAMUS 19 -- par Patrice Guinard
Excellent & moult utile Opuscule (Analyse du Traité des Fardements et des Confitures)
[Pour la transcription du texte, accompagnée de quelques notes, cf. CN 202, Sept. 2015]
La seconde édition du "Traité des Fardements et des Confitures" (TFC), revue et corrigée, est parue
à Lyon, chez Antoine Volant, en 1555 (cf. ma bibliographie consacrée
à cet ouvrage, CURA, Mars 2006). Elle est imprimée par Jean
Pullon de Trin (mention in fine). C'est le seul ouvrage publié au
nom de Michel de Nostredame, non parce qu'il n'aurait pas encore adopté
la forme latine Nostradamus : sa traduction manuscrite des Hieroglyphica
d'Horapollon daterait de 1541, ses premières pronostications sont sans doute
parues sous le nom de Nostradamus, et sa Pronostication pour l'an 1555,
dédicacée à Joseph des Panisses le 27 janvier 1554
et transmise par Daniel Ruzo, porte au titre la forme latinisée
de son nom. Si Nostradamus a choisi de conserver son patronyme, c'est parce
que le sujet de son ouvrage, en partie autobiographique, le lui commandait.
A noter qu'il signe Nostradamus dans sa traduction de la lettre à
Barbaro, qui clôt le recueil (p.223).
Au début du traité, Nostradamus se dit "Sextrophaea natus Gallia" (natif de Gaule où se trouve le trophée de Sextus, i.e. Saint-Rémy), en l'occurence
le cénotaphe des Julius, auquel il fait allusion au quatrain V 57. Il signe son faciebat du nom de Michaël Nostradamus Sextrophaeanus (originaire du lieu où se trouve le trophée de Sextus). Le
cénotaphe ou mausolée des Julii, en face de Glanum, aurait été édifié dans les années 30-20 BC par les frères Sextus, Lucius et Marcus Julius en l'honneur de leur père Caius et de leur
grand-père, officier de César. Constitué d'un socle orné de bas-reliefs représentant des scènes épiques (de l'ouest au sud : combat d'infanterie, de cavalerie, lutte contre les Amazones, chasse
au sanglier), d'un quadruple arc de triomphe aux colonnes corinthiennes (quadrifons) contenant une inscription sur la face nord, et d'une rotonde à dix colonnes corinthiennes (tholos) au sommet,
abritant, on le suppose, le père et le grand-père des Jules (têtes reconstituées). Il fait face à un Arc de Triomphe plus tardif (édifié vers 25 AD et dont la partie supérieure a été détruite),
évoquant la conquête de la Gaule. (cf. Agnès Vinas pour son étude des Antiques).

L'inscription dédicatoire est la suivante : SEX. L. M. IVLIEI C. F. PARENTIBVS SVEIS,
c'est-à-dire SEX(tus) L(ucius) M(arcus) IVLIEI C(aii) F(ilii) PARENTIBVS SVEIS,
ou SEX(tus) L(ucius) M(arcus) IVLII C(aii) F(ilii) PARENTIBVS SVIS
qu'on peut traduire par "Sextus, Lucius et Marcus, [tous trois] fils de Caius Julius, à leurs ancêtres". César
nous apprend que son père lisait Laetius et Maritus comme des autres prénoms de Sextus, et traduisait les abréviations C. F. par "Columnam Fecit" (érigea cette colonne) :
"Celle [inscription] qui est à S. Remy en l'Arc triomphal, qui est entier, est telle : S E X L M I I C F P A R E N T I B U S S S V I S. feu mon pere l'interpretoit ainsi
Sextus Laetius Maritus Iuliae istam columnam fecit" (L'entree de la Royne [Marie de Medicis] en sa ville de Sallon, 1602, D1v-D2r) - une version aussi attribuée à un Portugais
selon Bouche qui en recense dix autres dont la sienne (Chorographie 1, 1664, p.137-139) :
Sex(tae) L(egionis) M(ilitibus) Iuliae, Iuliae C(aesaris) F(iliae) PARENTIBVS SVIS (Émile Ferret)
Sex(to) L(aelio) M(onumentum) Iuliae intra C(irculum) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (Guillaume Budé)
Sex(tus) L(ucius) M(onumentum) Iuliae incondissimae C(onjugi) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (Mutonis)
Sex(tus) L(ucius) M(aximus) Iulii C(onsulis) F(ilius) PARENTIBVS SVIS (jésuite Varadier)
Sex(ti) L(iberii) M(ausolaeum) Iulii idibus C(uravit) F(ieri) PARENTIBVS SVIS (jésuite Jacques George)
Sex(tus) L(egavit) M(onumentum) Iuliae, Iulii C(aesaris) F(iliae) PARENTIBVSQVE SVIS (professeur aixois Jean de Bomy)
Sex(ti) L(ucii) M(andato) Iuliae impendio C(onditum) F(uit) PARENTIBVS SVIS (juriconsulte aixois Dominique Jorna)
Sex(ta) L(egionis) M(ilitibus) Iuliae intra C(irculum) F(ecit) PARENTIBVS SVIS (père Jean Jacques Augustin)
Sex(tae) L(egionis) M(ilites) intra C(irculum) F(ecerunt) PARENTIBVS SVIS (Joseph Maria Suarez, évêque de Vaison)
Sex(tus) L(ucius ou Laelius ou Liberius) M(aritus) Iuliae istud C(enotaphium) PARENTIBVS SVIS (Bouche)
La traduction actuelle retenue provient de l'abbé Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) qui dans son "Mémoire sur les anciens monumens de Rome" (in
Mémoires de Littérature, T 28, Paris, 1761, p.579) propose une treizième version, après notamment celles recensées par Bouche.

L'ouvrage de préparations cosmétiques et de recettes culinaires comprend deux parties et deux préfaces, l'une composée à Salon et dédiée au "lecteur benivole" : elle est datée
du 1er avril 1552, avec en clôture une énigmatique et intentionnelle sentence : "Toy disant à Dieu de saint Remy en Provence dite Sextrophaea" (en te disant adieu, de
St-Rémy-de-Provence, ou te disant/vouant au dieu de St-Rémy-de-Provence ?). L'autre, non datée, est
dédiée à son frère Jean de Nostredame, procureur à la cour du parlement d'Aix. Un faciebat sur la dernière page avant la table des matières est signé Michel
Nostradamus saint-rémois, et daté de 1552, et énigmatiquement de Salon sur le littoral : "Michaël Nostradamus Sextrophaeanus faciebat Salone
litoreae, 1552" -- une allusion possible à Salone, l'antique capitale de la Dalmatie (aujourd'hui Solin en Croatie), où l'empereur romain Dioclétien, persécuteur des
chrétiens, se retira dans son luxueux palais après avoir abandonné le pouvoir, à l'apogée de sa puissance, en mai 305 ("Salonae. Littoreae, dalmaticae", Jean Tixier
de Ravisi alias Ioannes Ravisius Textor, Epithetorum. Epitome, Lyon, Jean de Tournes & Guillaume Gazeau, 1558, p.316). Nostradamus aurait-il atteint ce point
de l'Adriatique lors de ses périples en Italie ? Ces obscurités, jointes à celles de la page 220 notamment (cf. infra), attestent pour le lecteur
non autiste, que le premier traité du saint-rémois, est d'une toute autre portée qu'un simple manuel de cuisine !
Le traité est rédigé dans un jargon parfois à peine compréhensible, et imprimé par l'éditeur avec
des écarts d'orthographe, d'une page à l'autre, difficilement justifiables, bien que la présentation d'ensemble (lettrines et
mise en page) soit soignée et de bonne facture. Les marques d'imprimerie se résument à 5 ou 6 lettrines
: les lettrines A, V et L, la lettrine P deux fois, et la lettrine C plus petite. (On retrouve le /L/ orné à la dédicace de Guillaume Drieu à Alexandre Ouderi, conseiller à la cour du parlement de Grenoble (Pronostique nouvelle pour l'an 1560, Lyon, Jean Pullon, dit de Trin pour l'auteur, [1559]), une
dédicace à l'imitation de celle de Nostradamus à Guillaume de Gadagne dans sa Pronostication nouvelle pour l'an 1558 ; cf. CN 73).
Copie PDF de l'exemplaire de Lyon,
incomplet, sur le site Gallica : il manque les pages 75 et 76 correspondant au chapitre XIX de la première partie, mais numéroté XX.

1. Le prologue au lecteur
Cet essai marque l'heure du bilan : Nostradamus a achevé son
apprentissage autodidacte d'apothicaire (qu'il revendique) et de
médecin en cette année 1552, et l'heure a sonné de
partager ce qu'il sait, ce qu'il a compris du monde, passé et à
venir : "& vins parachever mon estude jusques à l'heure presente,
qui est le trente un an de ma vacation, que tenons mil cinq cens cinquante
deux." [p.4]. Ses connaissances, il les a acquises sur le tas, dans
ses pérégrinations terrestres et livresques, et à
ses sources, comme Paracelse. En avril 1552, il a 48 ans, passés
de quelques mois : c'est l'âge exact où j'entreprends moi-même ce présent Corpus.
L'avant-propos ou prélude au texte (prooemium) est l'occasion saisie d'un véritable
étalage d'érudition : une trentaine d'auteurs sont mentionnés
: savants et philologues, médecins, philosophes, poètes,
parmi lesquels figurent Hippocrate, Galien, le médecin byzantin
Paul d'Égine, Platon et Marsile Ficin, Marc Varron, Cicéron,
les poètes Lucrèce et Lucilius, tous sans exception auteurs
de tradition gréco-romaine et leurs commentateurs modernes, humanistes
et érudits. Nostradamus s'inscrit dès son premier ouvrage
imprimé dans le mouvement de renouveau des lettres qui a pris naissance
en Italie et qui n'a fait que s'accélérer en Europe depuis
plus d'un demi-siècle. Et ce n'est pas un hasard si, parmi les maîtres
de son inspiration, ne figure aucun personnage biblique, auteur chrétien,
saint, ou théologien, pas plus qu'on ne relève de citation
évangélique, ni même biblique.
"Apres avoir consumé la plus grand part de mes jeunes ans
Ô LECTEUR BENIVOLE en la pharmaceutrie, & à la cognoissance
& perscrutation des simples par plusieurs terres & pays despuis
l'an 1521 jusques en l'an 1529 incessamment courant pour entendre &
savoir la source & origine des planetes [sic] & autres simples
concernans la fin de la faculté Iatrice : que apres avoir voulu
imiter la seule ombre de Paulus Aegineta, Non quod velim conferre magna
minutis [Non que je voudrais comparer le petit au grand] : mais
tant seulement diray, // Nostradami laborem me nosse, qui
plurimum terrae peragravit, Sextrophaea natus Gallia. [Apprends-moi
à connaître l'oeuvre de Nostradamus, natif du pays qui conserve
le trophée de Sextus et qui a voyagé à travers tant de contrées]" [p.3-4]
Paul d'Egine (dont on ne sait presque rien de la vie) reste en 1552 le modèle de Nostradamus qui déclare vouloir le suivre dans
son statut de "περιοδευτής" (periodeutes) c'est-à-dire de médecin itinérant.
Paulus Aegineta (ca. 625-685) obstétricien et le dernier médecin grec byzantin, est l'auteur d'une compilation médicale, ou
abrégé de médecine ("Epitome medicae"), en sept livres dans lesquels il déclare avoir voulu condenser l'essentiel et le meilleur de la
médecine classique. Son premier livre, qui traite d'hygiène et d'alimentation d'un point de vue médical (alimentation des nouveaux-nés, des
jeunes, des malades...), recouvre en partie la matière de l'ouvrage de Nostradamus. Le traité de Paul a été édité en grec en 1528 puis traduit à Bâle
et Paris les années suivantes :
Libri septem (1e édition, texte grec)
Venise, héritiers Aldus Manutius et Andrea Torresanus, 1528
019A Opus divinum (1e traduction latine)
Traduction Alban Thorer, Bâle, Andreas Cratender & Johannes Bebel, 1532, in-fol., 24 +
513 pp. ; BU Basel ou MDZ Munich
Opus de re medica (2e traduction latine)
Traduction Johann Winter, Paris, Simon de Colines, 1532, in-fol., 308 ff. ; MDZ Munich
Nostradamus se présente comme un chercheur itinérant et errant (planeticus) de plantes
médicinales (simples), comme son maître Scaliger. L'erreur typographique à la première page du
texte, planetes pour plantes, signalée par Buget (1861, p.69) et corrigée
manuellement sur l'exemplaire de Lyon, est maintenue dans l'édition
suivante (Olivier de Harsy, 1556, p.3). Mais s'agit-il d'une erreur ? Le jeu de mots
plantes/planètes (ou plantae/planetae en latin) exprimerait la source d'inspiration et
de guérison (iatrice) du corps et de l'âme humaine : la plante
soigne le corps, mais en harmonie avec les configurations planétaires,
impératif de la philosophie et de la pratique médicales de
la Renaissance. La plante est aussi, antérieurement à l'animal,
et au milieu cosmique et planétaire, la première source réelle
d'inspiration des phénomènes et développements culturels,
car elle provoque l'émotion, à l'origine de toute création,
selon la théorie de Léo Frobenius sur le destin des civilisations
(trad. franç. 1940). C'est par le saisissement, c'est-à-dire
par l'émotion compréhensive d'une réalité extérieure,
mais intérieurement appréhendée, que l'humanité,
à un moment de son histoire, s'approprie dans son corps et dans
son âme, que se transforme organiquement l'homme avant que n'apparaissent
les premières implications intellectuelles, culturelles, artistiques.
Un autre jeu de mot avec planètes est le terme planeticus (errant) suggérant un
voyageur "planétaire", intersidéral, ou plus justement "guidé par les astres". De même le
terme "pharmaceutrie" qui semble désigner les connaissances pharmaceutriques, se
rapporte d'abord au latin pharmaceutria (enchanteresse, magicienne) !
Nostradamus savait dès 1552, à moins que le texte de 1555 ait inclus quelques rajouts,
qu'il serait, par son esprit, par ses propos et par ses vers à déclamer, l'authentique réenchanteur du monde moderne.
Car ce que l'oeuvre de Nostradamus signifie n'est rien d'autre qu'une alternative, la seule (?), à la paumiscuité (PG 11-2018)
du monde moderne déliquescent.
Les indications autobiographiques qui parsèment son traité
sont très partielles, et Nostradamus reste discret sur sa vie privée
: pas un mot sur ses origines familiales ou sur son arrière-grand-père
maternel Jean de St-Rémy, lequel lui aurait enseigné la médecine
et l'astrologie, ni sur son premier mariage à Agen, ni sur ses diplômes (baccalauréat,
licence et doctorat) auxquels il n'attachait pas grande valeur, ni sur
son mariage ou sur son installation relativement récente (1547)
à Salon, où il se plaint à plusieurs reprises de n'être
entouré que de barbares et de "bêtes brutes" : "je suis
logé entre des gens barbares, ennemis der [sic] gens de bien,
or mis peu encores ignorants aux bonnes lettres." [p.122]. De son séjour
à Agen, il ne retient que sa rencontre avec Jules César Scaliger
dont il estimait l'érudition et auquel il a sans doute emprunté
le second prénom à la naissance de son fils César,
l'aîné de son second mariage : "mais une fois moy estant
[à] Agen en Agenois pais de la Gaule Aquitanique, & avec
Julius Caesar Squaliger home scavant & docte, un second Marcile Ficin
en philosophie Platonique." [p.12]
Nostradamus se révèle facétieux et farceur, loin
des clichés qui le présentent comme craintif, atterré
ou terrorisé par les catastrophes qu'il dépeint dans ses
Prophéties.
Lorsqu'il rapporte les oeuvres colossales des médecins de l'Antiquité,
il émet des doutes sur la profondeur de leur savoir : peut-on trouver
le temps à la fois d'étudier, de guérir des patients
et de faire l'expérience de la maladie sur le terrain, et d'en rendre
compte abondamment par ses écrits ? -- "car il n'est possible
que un personnaige qui a beaucoup de malades a veoir, qu'il puisse ne estudier,
ne rien escrire : & vrayement ceux qui ont beaucoup escrit en aucune
faculté, il [sic] n'avoient gueres de besognes a faire, car
l'esperit de celui qui redige par escrit ne demande que pacification :
ou il faudroit faire comme faisoit Julius Caesar qui escrivoit la nuict
ce qu'il faisoit le jour." [p.11]
Dans le huitain décasyllabique qu'il traduit du grec du poète
satirique Caius Lucilius (c.180-102), rapportant la version latine du poète humaiste et conseiller
autrichien Caspar Ursinus Velius (qui finira noyé à Vienne dans le Danube le 5 mars 1539),
"nonobstant qu'il ne touchat rien à la matiere" [p.19], Nostradamus déclare son peu d'expérience
pour la versification française, "Combien que ne soions pas trop exercitez en la poësie Francoise,
ce nonobstant avons traduict en Huictain", et le "prouve" avec le troisième
vers, de neuf syllabes, et le cinquième qui rime maladroitement avec le septième (pp.19-20) :
Combien que farde ta face enviellie,
N'ayes ja peur qu'on en oste les taches.
Puis que viellesse ainsi t'assaillie :
Il n'est besoing qu'a mettre tu ne tasches
A ton visaige aucun fard que tu scaiches :
Qu'a ton corps puisse donner emblanchiment :
Car sublimé, ne ceruse, ne tasche
De rendre vielle, jeune par fardement."
Pour le latin de Velius, cf. l'épigramme "In anum fucatam" de son traité poétique :
"Nil reliquum, quae est haec dementia : nam neque fucus / Nec cerussa Helenen
fecerit ex Hecuba." (in Poematum , Bâle, Johannes Frobenius, 1522, f.E2r).
Et, tout en affirmant les vertus de ses préparations, et en particulier
de son fard quasi miraculeux (préparation 1), ce "sublimé"
susceptible de transformer une Hécube en Hélène (pp.19,
24, 27, etc.), ou encore en Polyxène (p.41, cf. Ovide, Les Métamorphoses,
13, p.330), il mentionne et traduit l'épigramme de Lucilius qui
ironise sur le fait que les meilleures recettes esthétiques ne peuvent
venir à bout des ravages du temps sur la beauté, des femmes
en particulier, et, ajoute-t-il : "toute femme mesmes celle qui fait
souvent enfant se deschet tout les ans de cinq pour cent" [p.23] !
Ainsi une jeune femme de 32 ans aura perdu après quatorze années
plus de la moitié de sa beauté. Je crois que Nostradamus
y va un peu fort sur le pourcentage, et j'opterai plutôt pour un
taux de 3% ... Mais parallèlement, sa teinture noire pour les cheveux
sera susceptible de métamorphoser un vieillard comme Priam, au point
de le faire paraître aussi jeune que son fils cadet (chapitre 31,
p.112) -- sans doute à la manière de Dirk Bogarde dans Morte a Venezia ...
2. Le traité des Fardements
Le livre des Fardements est un recueil original de 34 préparations
cosmétiques, fondé sur son expérience des plantes
et des substances minérales, et qu'il souhaite mettre à la
portée de tous, même s'il déclare que son
"Opuscule a esté redigé à la requeste d'une grand princesse"
[p.92], laquelle n'a peut-être pas souhaité être mentionnée.
L'inspiratrice du traité pourrait être la princesse Marguerite
(1523-1574), soeur de Henry II, et mariée à la mort tragique
de son frère au duc de Savoie Emmanuel-Philibert. L'Almanach
pour l'an 1561 sera dédié à la duchesse de Savoie,
après sa rencontre avec Nostradamus à Salon en septembre 1559.
Son expérience des plantes, de leur traitement et de leurs mélanges,
ne va pas sans une "cognoissance de l'astrologie, que maintenant commence
quelque peu a soy relever, que tant de temps a demeuré a mespris,
que moyennant le sçavoir d'icelle l'on venoit facilement à
ceste occulte philosophie" [p.116]. Et Nostradamus révèle
dans ce traité sa préoccupation majeure et son objectif premier
: l'occulte philosophie ainsi nommée ici comme dans la première
préface à ses Prophéties, via l'astrologie
(mais sans la plupart des astrologues !), pour atteindre la sagesse des
deux penseurs qu'il considère comme en étant les fondateurs
et les piliers : à savoir Pythagore et Platon.
Les préparations variées du livre des Fardements regroupent
des fards et des parfums, des huiles et des poudres, des pommades et des
teintures, des onguents et des lotions. Notons : un fond de teint appelé
sublimé pour l'emblanchiment du visage (chaps.1 & 2), une huile
de muscade contre les vomissements et les maux de ventre (chaps.6 &
7), une poudre odorante susceptible de chasser les odeurs pestilentielles
(chap.8), une poudre à base de violettes (chap.9), une poudre et
une pâte dentifrice (chaps.13 & 14), des savons pour les mains
et pour la barbe (chaps.19 & 20), une eau distillée pour le
visage (chap.22), des teintures pour blondir les cheveux (chaps.24 &
25), ou pour noircir les cheveux et la barbe (chaps.28 à 31), un
fard pour blanchir la peau à base de plantes et d'amidon (chap.34),
et même un filtre amoureux, ou poculum amatorium ad Venerem
(chap.18, p.69 : hasard de la mise en page ou participation facétieuse de
l'auteur à sa réalisation ?) qui a scandalisé les esprits puritains.
Sa préparation à base de fleurs a pour fonction de purifier
l'air et d'en chasser les relents pestilentiels. En voici la recette (que
ne reproduit pas la traduction anglaise d'une contrefaçon qui lui
sera attribuée ; cf. "Le pseudo-traité
de la peste de 1559", CORPUS NOSTRADAMUS 32) :
"Prenes de ferrature ou le rament du boys de cypres le plus verd que
vous pourres trouver une once [30 g], de hyris de Florence six onces
[185 g], de girofles iii onces [90 g], calami odorati [roseau aromatique, lis
des marais] iii dragmes [11 g], ligni aloes vi dragmes [23 g], faite
le tout mettre en pouldre qu'il ne s'esvente : & puis prenes de roses
rouges incarnees trois ou quatre cents qui soient bien mondees toutes fraiches
que soient cuillies avant la rosee : & les feres fort piller dens un
mortier de marbre avec un pestel de bois : & quand les roses seront
a demy pillees, mettes y dedens la pouldre susdite, & le tournes piller
fort, & en arrousant un peu de suc de roses : & quand le tout sera
bien meslé, faites en de petites balotes plates, faites en la mode
de trocis : & les faites seicher à l'ombre : car elles sont
de bonne odeur." (chap.8, p.49).
L'insipide Marconville barbouille en 1564 : "Je ne me puis assez emerveiller
de l'impudence effrenée & lourde bestise, de ceulx qui ont escrit
de nostre temps la maniere de faire les potions amatoires, que Nostradamus,
en son livre des fardemens, appelle buvandes, & les Grecz Philtra,
aucuns Amuletum Veneris (...) Ledict Nostradamus descrit la façon
& maniere de ceste buvande, laquelle vault beaucoup mieux ignorée
que sceüe, pour le peril de l'abuz. Mais il seroit besoing d'exercer
la severité & rigueur des loix contre ceulx qui escrivent ou
enseignent telle maniere de receptes, indignes de l'homme de bien, &
beaucoup plus de Chrestien." (in Recueil memorable d'aucuns cas
merveilleux advenuz de noz ans, Paris, Jean Dallier, 1564, f.108r-v).
Cet ouvrage est d'ailleurs la première attestation explicite et
formelle de l'existence du TFC, vingt ans avant les recensements de La
Croix du Maine et de Du Verdier.
Le traité des fardements est signalé dès 1567 par Leo Suavius dans une édition paracelsienne,
soit quelques années avant la parution de sa traduction allemande, aux pages 316 (allusion
au philtre d'amour) et 326 de l'ouvrage : ex libro recenti Nostradami de Fucis & unguentis muliebribus [d'après
le récent ouvrage de Nostradamus sur les fards et onguents destiné aux femmes] (Paracelsus, De
vita longua, & Leo Suavius, Scholia, Bâle, Petrus Perna, 1568, p.326)" (cf. CN 09).
Autour de la page 52 (pages 50 à 54) se situe le fameux récit
de la peste d'Aix de 1546-1547, rédigé par Nostradamus en
1552, puis compilé sans indication de source par Pierre Boaistuau en 1558 (cf. le
texte ci-dessus, pour lequel j'ai introduit quelques séparations pour
plus de lisibilité). Ce récit a pu faire croire que Nostradamus
aurait écrit un traité spécifique sur la peste, ainsi
que l'évocation de certaines maladies mentionnées dans son
traité, comme le "mal epilentique" (p.113). Au chapitre 26, Nostradamus
présente une composition "que souvent ay fait faire pour monseigneur
le reverendissime Evesque de Carcassone, monseigneur Ammanien de Foys"
[p.92]. Un certain "Emanicu" (probablement pour transcrire Emanien), évêque
de Mâcon et protonotaire du siège apostolique, dédicataire
du pseudo-traité de la peste dont il subsiste une copie en traduction
anglaise, a été identifié à Ammanien encore
évêque de Carcassonne en 1552 (Brind'Amour, 1993, p.480).
[p.50] L'an mil cinq cens quarante six que je feus esleu & stipendié
de la cité d'Aix en Provence, où par le senat & peuple
je fus mis pour la conservation de la cité, où la peste estoit
tant grande, & tant espouventable, que commença le dernier de
May, & dura neuf moys tous entiers, où mouroit de peuple sans
comparaison de tous eages en mangeant, & en beuvant, que les cymetieres
estoient si pleins des corps morts, que l'on [p.51] ne sçavoit
plus lieu sacré pour les enterer : & la plus grand part tomboient
en phrenesie au second jour : & ceux ausquelz la phrenesie venoit,
les tasches ne venoient point : & ceux à qui les tasches venoient,
ilz mouroient subitement en parlans sans avoir nulle alteration de bouche,
mais apres la mort toute la personne estoit couverte de tasches noires
: & ceux qui mouroient avec phrenesie leurs urines estoient subtiles
comme vin blanc : & apres leur deces la moytie de tout le corps estoit
de la couleur du ciel rempli de sang violet : & la contagion estoit
si violente & maligne, que seulement si l'on s'approchoit cinq pas
pres d'un qui feusse pestifere, tant qu'il [y] en avoit tous estoient
blecez : & plusieurs avoient charbons devant & derriere, &
mesmes par toutes les jambes : & ceux qui les avoient derriere la personne
leur donnoit une demangeson : & la plus grand part de ceux la eschapoient
: mais tous ceux qui les avoient devant n'en eschapoit pas un.
Feurent peuz qui eussent les apparences derriere les oreilles : &
feut au commencement, & vivoient jusques à six jours : &
j'estois esbahy qu'ilz mouroient plustost au sixiesme que au septieme jour,
sinon pour cause de la tyrannie de la [p.52] maladie : & vers
le commencement & le millieu n'en eschappoit pas un : les saignees,
les medicamens cordiaux, catartiques, ne autres n'avoient non plus d'efficace
que rien : la tyriaque d'Andromachus composé[e] justement
au vray n'avoit lieu : la fureur de la maladie estoit si enflamee, qu'il
n'en eschappat pas un : quand on avoit fait la visitation par toute la
cité, & jette hors les pestiferes, le lendemain en y avoit plus
que au paravant [sic] : & ne trouva on medicament au monde qui
feusse plus preservatif de peste qu'estoit ceste composition : & tous
ceux qui en portoient & tenoient à la bouche estoient preservez
: & devers la fin on trouva par une experience manifeste que cecy preserva
un monde de la contagion : & combien que le fait n'appartient à
la matiere de quoy nous parlons, si est ce qu'il n'a pas esté estrange
raison d'avoir raconté le secours qu'il nous a fait en temps pestilentieux
: car celle peste que feut lors, estoit tant maligne, que c'estoit chose
espouventable : plusieurs affermoient que c'estoit punition divine : car
à une lieue tout à l'entour n'y avoit que bonne santé
: & toute la ville estoit tant infecte, que seulement du seul regard
que faisoit celuy qui estoit contaminé venoit subitement donner
[p.53] infection à un autre : les vivres estoient en abondance
& de toute sorte presque à vil pris : mais la mort estoit tant
subite effreneement que le pere ne tenoit compte de son enfant : sont estes
plusieurs qui ont abandonnes [sic] leurs femmes & enfans quand
ilz cognoissoient qu'ilz estoient frappes de la peste.
Plusieurs entaches de peste par phrenesie se sont jettez dens les
puiz : d'autres se sont precipitez de leurs fenestres en bas sur le pavé
: d'autres qui avoient le charbon derriere l'espaule, & devant la mamelle
leur venoit une saignee du nez qui duroit nuict & jour violentement,
qui mouroient : les femmes enceintes venoient avourtir, & au bout de
quatre jours mouroient : & trouvoit on que l'enfant mouroit subitement,
& le luy trouvoit on tasché tout le corps d'une couleur violete,
comme si le sang eut esté espandu par tout le corps.
Au brief parler la desolation estoit si grande, que avec l'or &
l'argent à la main souventesfois mouroit on par faute d'un verre
d'eau : & si je venois ordonner quelque medicament pour ceux qui estoient
blecez, l'on le apportoit la : & estoit administré pourement,
tant que plusieurs mouroient le morceau à la bouche.
Entre les choses admirables que je pense [p.54] d'avoir veu
: c'est que j'ay veu une femme que ce pendant que je l'allis veoir, &
en l'appellant par la fenestre, me respondre & me rendre response de
ce que je luy disois, sortir à la fenestre qu'elle mesme toute seule
se cousoit le linceul sur sa personne commençant aux piedz, venir
les alabres que nous disons en nostre langue Provençale qui portent
& ensevelissent les pestiferes, entrer dens la maison de ceste femme,
& la trouver morte & couchee au millieu de la maison avec son suere
demy cousu : & cela fut à trois ou quatre parts à la
ville : & de l'une moymesme je l'ay veu : & eusse voluntiers raconte
d'avantaige tout le fait de la pestilence que avint à ladite ville
: mais ce seroit rendre nostre labeur confus.
Au chapitre 27 et autour de la page 100, Nostradamus se livre à
une description précise de ses relations avec les milieux médicaux
et "pharmaceutiques", et dresse un réquisitoire au ton étonnamment
moderne contre la cupidité et l'appât du gain qui engendrent
lâcheté et incompétence. Ce discours rassemble tous
les ingrédients nécessaires pour déplaire aux censeurs,
inquisiteurs et autres esprits politiquement corrects de l'époque
: la situation n'a fait que s'empirer depuis ce temps, et les laboratoires
pharmaceutiques, les usines de cosmétiques, et nombre d'officines
médicales n'ont en vue que le souci d'augmenter leurs profits et
leurs revenus, au détriment de la santé ou de la solidarité.
[p.98] Ne vous fies pas à tous apotichaires,
que vous promes, que pour un qu'il en y a de bon, qu'il en y a cent &
mille qui sont meschants, ou les uns sont pou[v]res qu'il [sic]
n'ont dequoy la faire : les autres sont riches & puissants, mais il
[sic] sont avares & corrompus, que pour paour de n'estre payé à
leur gre, n'y mettront la moytie, ny possible [p.99] le tiers du
contenu de la recepte : les autres sont ignorants, qui rien ne sçavent,
ne veulent sçavoir : qui est un meschant vice à un home de
tel estat : les autres sont salles, & mal netz, qui font ce qu'ilz
font deshonnestement. Je ne dis point qu'il n'y en ayt qui ont le tout
: ilz ont dequoy : ilz ont bonne conscience : ilz ont le sçavoir,
mais ilz sont negligentz & commandent de le faire à quelques
uns qui le font mal. Je ne veulx pas desnier, qu'il n'y en soient plusieurs
que ce qu'ilz font ne soit bien fait : mais cela est bien rare.
J'ay suivy tout le royaulme de France, au moins
la plus grand part, & ay hanté & cogneu plusieurs apotichaires,
mais j'ay veu faire de choses tant enormes, que ne pense que en toutes
les arts manuelles mechaniques ou y courent plus d'abus qu'il se fait en
l'art de la pharmaceutrie, & plus de charge de conscience : que si
je voulois escrire la centiesme partie, que comme tesmoing oculaire je
puis affirmer, le papier ne feroit asses suffisant de le mettre par escrit
: non que je veuille taxer personne de ce monde, ja au souverain Soleil
ne plaise me faire participant de sa immense splendeur : mais en voiant
le monde pour apprendre & cognoistre les qualités, [p.100]
complexions & nations des gens, & voir la clemence & inclemence de l'air,
& les diverses nations du monde, mesrne pour la cognoissance des simples
que en aucunes regions sont, aux autres ne sont : & principalement
pour voir les antiques topographies faites du temps du siecle Romain :
& en exerceant la faculte de medicine, ou gist ma principale profession,
ay cogneu tans d'abus, & en tant de diverses citez, que pour n'offencer
les oreilles des uns & des autres je changeray de propos
: comme a fait Lucien in Encomio Demosthenis, de celuy qui alla peindre le
cheval qu'estoit couché, & il le vouloit courrant, j'ay bien
esté en plusieurs parts que la faculte de medicine est noblement
mise en exequution : mais cela n'est pas si souvent qu'il est jour : car
cas advenant que quelque medicin arrive a la boutique d'un pharmacopolle,
& pour satisfaire a quelque malade il vouldra voir faire les medicines,
& les peser comme il est bien raison, mesmes quand on cognoist un apotichaire
ignorant : & lors l'apotichaire, possible sera quelque ignorant idiot,
fol, glorieux, & temeraire, outrecuydé, ou esventé, phantastique,
car tout par tout en y a de bons & de maulvais, dira a ce jeune medicin,
& quoy me voules vous icy conteroler ?
[p.101] Penses vous qu'on ne soit pas home
de bien ? Je veux bien que vous sçaiches, que je le ferai beaucoup
mieulx que vous ne le scauries ordonner : parquoy mesles vous de faire
vostre eftat : & ne vous empesches pas de noz drogues : car je feray
mieux cela que vous ne le sçauries entendre : & mille autres
propos qu'ilz disent, & qu'ilz font que encores je n'ose escrire la
douziesme partie de ce qu'ilz font les meschantz : veritablement en ay
cogneu de forts gens de bien, qui entendent tresbien leur art, & que
la faisoient aussi : & au lieu ou je feusse jamais que l'art de la
medicine feusse mal administree c'estoit a Marseille, or mis deux ou trois
: & s'il n'estoient messieurs les docteurs en medicine qu'ilz y sont
gens de bien, & sçavans seroit plus mal : mais messire Loys
Serre home sçavant & docte, & en presaiges un second Hippocrates
la fait administrer de tout son pouvoir justement : si je vouloys reciter
toutes les villes que j'ay practiqué, ou la medicine se fait bien
& mal, nostre livre seroit par trop enorme, donnant toutesfoys la palme
(sans que les autres gens de bien en soient participant) tant de sa cité
que d'ailleurs à Joseph Turel Mercurin de la cité d'Aix en
Provence: & de present a nostre ville de Salon a François Berard :
[p.102] combien que l'on pourroit dire que
je n'ay pas hanté n'y experimenté les autres, que despuis
en la ont changé de faire, nenny vrayement : car celle n'est possible,
pour ce que la vie de l'home est bresve : & feray fin [sic]
de telz propos, que je suis certain, que sont plusieurs qui ne sont pas
contens, & lairrons ce propos qui ne sert que de animer le coeur des
malins, qui usent souvent la succidanea [subterfuge], qu'lz
[sic] facent que leur ame ne soit blesee.
Le discours de Nostradamus rappelle l'idée de l'humaniste Guillaume
Budé, parfois encensé mais rarement lu : "Il n'y a cependant
personne qui ne voie et comprenne que toute la race humaine est aiguillonnée
par le souci d'accroître ses revenus, comme elle le serait par un
taon engendré par elle et demeurant en elle." (Lettre à Thomas
Lupset, du 31 juillet 1517 ; in Thomas More, L'Utopie, éd. 1978).
Paracelse s'en prend lui aussi avec véhémence aux médecins et apothicaires de son temps.
C'est bien de l'argent, ce fléau du cerveau, des sensibilités
et des consciences, plus ravageur et destructif aujourd'hui qu'il ne l'était
il y a quatre ou cinq siècles, dont il est encore question dans
ce passage de la seconde partie du traité : "quand Homere parloit & les autres
de l'ame au ciel, ne se pouvoit il pas entendre, Strenuorum immortale nomen ? ["les
noms des braves sont immortels" ; cf. Alciat, Emblemata, Lyon, éd. M. Bonhomme, 1551, p.147, d'après
Pausanias ou le 3e livre des épigrammes grecques] mais vrayement ilz
preferent la richesse de ce miserable monde, qui tost perit à celle
que par les lettres seroit à tout jamais pardurable. Mais ilz sont
comme Tantalus, tant tant, & si n'ont rien. Mais nous reviendrons au
chemin d'ou nous sommes venus, pour donner advis à quelques uns,
qui auront cognoissance de plusieurs gents : & laissons à part
ceux qui ont sçavoir & pouvoir, qui aiment mieulx un escu, que
s'ilz avoient prins peine d'escrire une heure : ce que je cognois plusieurs
qui ont le sçavoir pour le faire : mais la richesse les aveugle,
& pensent avoir bonne raison, & ilz seront bien deceuz. Peribit
memoria eorum sine sonitu, ["leur mémoire périra sans
faire de bruit"] non pas d'erain. [p.218]
La plouto-technocratie actuelle est le pire des régimes pour
l'esprit, et les (ir)responsables de l'uniformisation de la culture, qui
quémandent auprès des services publics plus de moyens techniques
et financiers, et plus de personnel, feraient mieux de demander des hommes.
Enfin, l'emploi de certaines formules, pour le moins peu catholiques,
et pas plus protestantes, en dépit des éthiques et étiquettes
qu'on cherche à lui faire endosser (Dupèbe par exemple, ou
à l'opposé, dans le petit monde étriqué des
idéologies chrétiennes, un Lemesurier), traduit et trahit
certainement les véritables aspirations, mystiques et panthéistes,
aux accents spinozistes (deus sive natura), de l'auteur, encore
assez peu avisé des puissants clans, cliques et ligues plus ou moins
engagées qui ont cherché à enserrer la connaissance
de "l'esprit" sous le manteau de leurs lubies respectives, et pas encore
assez rusé pour donner le change : "pleut au souverain soleil,
qui est la vraye lumiere de Dieu" [p.74], "au souverain Soleil ne
plaise me faire participant de sa immense splendeur" [p.99].
Les 34 recettes du Livre des Fardements
01. p. 25 - Pour accoustrer le sublimé
02. p. 33 - Vn' autre mode pour bien preparer & accoustrer le sublimé
03. p. 36 - Pour faire pommade d'une souveraine odeur, bonté & excellence
04. p. 42 - La façon vraye pour faire l'huylle de benjoin
05. p. 45 - Autre façon pour faire huylle de benjoin
06. p. 46 - Pour faire huylle de noix muscade en toute perfaiction
07. p. 47 - Autre maniere pour faire le susdit huylle
08. p. 48 - Pour faire la principale matiere pour pouldre de senteur
09. p. 54 - Pour faire pouldre de violete
10. p. 55 - Pour faire une paste (...) pour paster les pommes de senteur, ou pour faire des patinostres
11. p. 57 - Autre annotation pour composer pommes de senteur
12. p. 60 - Pour faire autres pommes de senteurs non guieres moindres que les premieres
13. p. 61 - Pouldre pour nettoyer & emblanchir les dentz, & rendre l'haleine doulce
14. p. 61 - Vn' autre façon plus excellente pour nettoyer les dentz
15. p. 63 - S'ensuyt l'eaue de senteurs pour arrouser noz formes
16. p. 64 - Et notes que de ceste eaue, mais qu'elle soit coullee bien subtilement, s'en fait un fard
17. p. 65 - Pour faire huylle de senteur
18. p. 69 - Pour composer au vray le poculum amatorium ad Venerem
19. p. 75 - Pour faire une maniere de savon muscat qui emblanchit & adoucist les mains [chapitre "XX" par erreur]
20. p. 77 - Autre maniere de savon muscat pour la barbe
21. p. 79 - Pour faire Bourrax artificiel clayr comme sucre candi
22. p. 80 - La forme pour faire un eau distillee pour emblanchir & illustrer parfaitement la face
23. p. 84 - Pour faire au vray le laict virginal (...) pour emblanchir la face
24. p. 86 - Pour faire venir les cheveulx blonds comme un fillet d'or
25. p. 88 - Une autre façon pour faire le poil de la barbe blond, & de couleur doree
26. p. 92 - S'ensuit une tressouveraine & tresutile composition, pour la sante du corps
27. p. 97 - S'ensuyt la maniere comme il faut user de la susdite composition
28. p.102 - Pour faire les cheveux de la barbe noirs pour blancz qu'ilz soient
29. p.104 - Pour faire savon noir qui ennoircit la barbe & subitement
30. p.106 - Pour faire un huylle qui est de couleur noire, qui fait venir le poil noir
31. p.108 - Pour faire l'huylle (...) que en touchant le poil, incontinent changeoit en un instant de couleur devenant noire
32. p.117 - Pour accoustrer le nacre prosopopeye (...) pour embellir & emblanchir la face
33. p.120 - Vne souveraine nocturne application pour oster les lentilles du visaige
34. p.122 - S'ensuit un fard pour emblanchir la face, & la conservant longuement en beaute
3. Le traité des Confitures
Le livre des Fardements traitait de l'apparence physique, de l'extériorité
corporelle, du look, du dehors : le livre des Confitures traite
de "l'intériorité corporelle", de la subsistance à
travers la nutrition, l'alimentation, la digestion, du dedans.
Les recettes proposées par Nostradamus, principalement des confitures
et des gelées, relèvent de la confiserie et de l'oenologie.
La bonne utilisation du sucre, du miel plus abordable, et des épices,
reste l'essentiel du savoir-faire de Nostradamus. Notons : une confiture
de citron (chap.1), une confiture de courge aux vertus médicinales,
pour tempérer "la chaleur exuberante du coeur et du foie" (chap.2),
une confiture de noix sans sucre ni miel (chap.5), un vin cuit appelé
"defrutum" par Varron (chap.6), le traitement de la cassonade ou du sucre
gâté (chap.7 bis), une confiture de gingembre (chap.11), le
traitement de l'eau de gingembre pour la préparation du vin apéritif
appelé "hippocras" (chap.12), de la gelée de coings (chaps.15,
16 & 17), une recette de santé et de rajeunissement, chassant
"toute melancholie" à partir d'écorces de buglosse (chap.23),
une recette pour le sucre candi (chap.25), une tarte de massepain (chap.27),
un sirop laxatif à partir de roses rouges (chaps. 29 & 30).
Pour les amateurs d'expériences culinaires, quelques mesures
de poids d'après l'ouvrage de Pierre Charbonnier (1994) :
- un denier (ou scrupule) de 24 grains = 1,27 g
- une once de 8 gros (ou 8 drachmes) = environ 24 deniers = 30,6 g
(environ une cuillère à soupe)
- une livre de Paris ou poids de marc, de 16 onces = 2 marcs = 489,5
g (bijoutiers, pharmaciens)
- [la livre poids de romaine, pour le commerce de gros, et des quantités
de plus de 20 livres = 403 g]
- [la livre poids de balance, pour le commerce de détail = 380
g -- mais 376 g à Salon, 379 g à Aix, 388 g à Marseille]
- un pot (de vin) = 1,073 litre à Marseille, 1,203 litre à
Aix, mais 1,302 litre à Salon
Hippocrate et Galien avaient vanté les bienfaits médicinaux
du vin, et l'appellation "hippocras" ou hypocras pour le fameux apéritif
médiéval épicé et fortifiant proviendrait du
nom du médecin grec. Rabelais mentionne l'hippocras clairet et l'hippocras
blanc dans son Tiers Livre (chaps. 30 & 32, pp.448 & 455).
Et Nostradamus déclare avoir confié sa recette de l'hypocras
à son compatriote salonais : "je l'ay autrefoys fait faire à nostre
Françoys Berard, qui puis la vendoit comme d'une espicerie toute
nouvelle." [p.166]
Nostradamus aurait-il abusé de sa propre recette ? C'est
ce que suggère Buget qui écrit que son style "ressemble un
peu au langage d'un homme ivre." (1861, p.70). Jean-Paul Clébert, qui se présente en provençal
familier de Nostradamus et qui en dresse un portrait comme s'il en avait
été le concierge, le dépeint comme un ivrogne impénitent,
qui cultive son inspiration dans les vapeurs d'alcool : "Il boit comme
un trou, comme un puits, ce bon petit vin de Crau qui ne se transporte
pas mais le transporte en cet état second où tout semble
s'expliquer." (in Nostradamus, Aix-en-Provence, Édisud, 1993, p.108).
Divers recueils culinaires sont imprimés en français à
partir de 1486 : le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent,
le Platine en françois (de l'italien Bartolomeo Sacchi dit
Platina), et un Livre de cuysine parisien dont la première
version a été imprimée dans les années 1530.
Le premier ouvrage traitant spécifiquement de confitures et de vins,
mais aussi de "fardements", est paru en 1545 (Paris, Jehan Longis) : c'est
le Petit traicté contenant la maniere pour faire toutes confitures,
compostes, vins saulges, muscadetz & autres breuvages, parfuncts savons,
muscads pouldres, moutardes, & plusieurs autres bonnes recettes,
basé sur un réceptaire manuscrit du XVe siècle, en
quelque sorte le précurseur du TFC. Deux rééditions
de cet ouvrage suivront : chez Benoist Rigaud en 1558, et chez Jehan Bonfons,
peut-être dans les années 1560, sous le titre : Maniere
de faire toutes confitures, avec la vertu et proprieté du vinaigre.
(Sur cet ouvrage et sur sa source manuscrite, voir la thèse de Florence
Dufournier, Édition critique et commentée d'un réceptaire
de la fin du XVe siècle (Paris IV-Sorbonne, 1997), et l'article
de Philip et Mary Hyman dans l'ouvrage collectif : Livres en bouche,
Paris, 2001, p.59).
Apparemment, Nostradamus ne connaissait pas ce texte : "je seray
le premier, qui en ceste matiere de ce second traicté en nostre
langue a monstré le passaige, & a couppé la glace"
[p.161] ; "ce petit Livre, que je vous presente par estreines de nouvellete." [p.221]
Le livre des Confitures s'achève sur une note étonnante
et énigmatique, et même si Nostradamus précise à
la dernière page de ce livre que "si quelqu'un a parfaite intelligence
de sçavoir cognoistre la maistrise de bien & deuement gouverner
le succre, il mettra tous fruitz en parfaite confiture." [p.221], on
sent bien qu'il est question de tout autre chose, et que le voyant salonais
n'a pas entrepris cet ouvrage pour nous entretenir seulement de poudres
et de confitures, n'en déplaise à certaines lectures naïves !
Pourtant amy lecteur si tu voys quelque matiere, laquelle
ne te soit agreable, ou par novité te faille retirer le front, je
te diray ce qu'ay veu engravé en marbre. Credis sum Pythiovera
magis tripode. Vray est qu'il y a beaucoup de choses, que sont chieres
& difficiles a faire : mais si tu veux dens ton cerveau calculer, ne
trouveras chose que ne soit que par trop facile a faire : mais qui vouldroit
user d'une par trop severe avarice, il pourroit bien estre, que l'intention
de quoy l'on pretend seroit frustrée. [p.220]


A la fin de l'ouvrage sont annexés deux suppléments :
à la page 222, une épigramme de 6 vers (hexastichum)
précédée d'un avertissement, le tout en latin et adressé
à Nostradamus. On ignore quel en est l'auteur : Nostradamus lui-même
? Un ancien camarade de l'université de Montpellier ? En voici la traduction :
"En recommandation du très célèbre docteur de la
faculté de médecine, ce petit livre de notre maître [D. N.
= Dominus Noster] Michel Nostradamus, qui apportera au lecteur
candide une commodité qui n'est pas mince.
Salut, docteur Michel, très digne des plus grands éloges,
Que de grandes récompenses couronnent tes études.
Tu dévoiles par ce petit livre de nombreux préceptes:
Et ainsi ton travail personnel sera utile à beaucoup.
La jeunesse doit se recommander de ton enseignement,
Et les plus âgés loueront tes écrits comme dignes
d'attention."
L'épigramme est suivie de la traduction par Nostradamus d'une
lettre d'Ermolao Barbaro à Pietro Cara (ca. 1440-1501), écrite à Milan
et datée du 6 mai 1488, décrivant un banquet au cours duquel
sont présentés aux convives 15 plats successifs (pp.223-228).
Le texte est repris ou plutôt "récité" par César
Nostradamus qui en donne une autre traduction d'après la lettre
de Barbaro : "je veux par un court & gracieux devoyement reciter la
magnificence des nopces de Trivulce." (Histoire, pp.692-693).
Les 30 recettes du Livre des Confitures
01. p.133 - Et premierement pour confire l'escorce, ou la chair du citron avec le succre
02. p.137 - Pour confire la chair de courdes que l'on nomme cocordat ou carabassat
03. p.140 - Pour confire l'orengeat en succre, ou en miel
04. p.143 - Pour confire les orenges
05. p.144 - Pour confire les noix ou autre confiture sans miel, & sans succre
06. p.146 - Pour faire le vin cuit que Marcus Varro nomme Defrutum
07. p.150 - Pour faire laictues confites en succre [et] La façon pour clarifier la cassonade, ou le succre qui est noir
08. p.154 - Pour faire la confiture des guignes ou agryotes
09. p.156 - Pour faire la gellee des guignes
10. p.159 - Vn' autre mode pour faire gellee de guignes
11. p.162 - Pour faire la confiture du gyngembre verd [chapitre "XII" par erreur]
12. p.165 - Pour conserver l'eau du gyngembre, qui est pour faire bonne pouldre, pour faire souverain vin hippocras
13. p.167 - Pour faire d'une racine confite qui est Hyringus
14. p.169 - Pour faire des amandes confites des verdes, par lors qu'elles sont demy meures
15. p.172 - Pour faire gellée de coings (...) pour presenter devant un Roy
16. p.174 - Autre façon pour faire gellée de coings (...) pour princes, ou grandz seigneurs
17. p.177 - Autre façon pour faire gellée de coings en roche
18. p.179 - Pour confire petitz limons & orenges tous entiers
19. p.182 - Pour confire des coings à cartiers
20. p.184 - Pour confire les coings à cartiers avec le vin cuit
21. p.186 - Pour faire du codignat
22. p.187 - Pour faire une autre façon de coings à cartiers avec le succre
23. p.190 - Pour confire l'escorce de buglosse
24. p.193 - Pour faire poires confites
25. p.195 - Pour faire le succre candi
26. p.199 - Pour faire le pignolat en roche
27. p.203 - Pour faire tartre de massapan, que Hermolaus en l'epistre sequente nomme Martios panes
28. p.205 - Pour faire les penites, que nous appellons succre panys
29. p.210 - Pour faire syrop rosat laxatif
30. p.214 - Autre façon pour faire le syrop rosat laxatif
4. Voyages et rencontres, relations et lectures
Nostradamus parsème son traité de quelques précieuses
indications autobiographiques sur son activité, ses relations, ses
déplacements. De 1521 à 1529, il est étudiant autodidacte
et itinérant (p.3) quoiqu'il laisse entendre qu'il exerce la médecine
dès 1521 (p.4). Autant dire qu'il ne considère pas le diplôme
comme sanction légitime de la profession, et ne mentionne pas son
doctorat de médecine qu'il a pourtant dû passer à la
faculté de médecine de Montpellier au début des années 30.
Il a séjourné et probablement exercé en diverses
cités de Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné et Lyonnais
: "Je suis este en plusieurs & diverses regions du monde, &
ay hanté les uns & les autres que les [confitures de guignes]
faisoient d'une sorte, que les faisoient de l'autre : que si je voulois
escrire par tout la ou j'ay veu, le papier ne seroit asses suffisant :
j'eusse pensé que le pais d'Italie feusse le souverain pour ce faire
: mais quand en cest endroit, au moins la ou j'ay veu, ilz en usent
bien golphement : j'ay veu la façon de Thoulouse, de plusieurs de
Bourdeaulx, de la Rochelle : brief de tout le pais de Guienne & Languedoc,
& de toute la Provence, du Daulphiné, du Lyonois : mais je n'ay
jamais trouvé de plus belles que ces icy n'y [sic] meilleures.
[pp.155-156].
"J'ay autrefois practiqué en la cité de Bourdeaux,
de Thoulouse, Narbonne, Carcassonne ; & la plus grand part au pays
d'Agenois : Agen mesmes la ou, la faculte de Medicine estoit souverainement
faite, & a esté resuscitée en son plus hault degré,
non pas tant seulemens la Medicine, mais toute Philosophie Platonique" [p.218].
Il est à Avignon en 1526 (p.176), à Bordeaux en 1539 (p.110),
à Aix de juin 1946 à février 1947 environ et à
Lyon en 1547 lors des épidémies de peste (pp.50 & 216),
à Gênes et à Savone en 1549 (pp.59 & 202).
Il se sent à l'étroit à Salon, sa ville de résidence
depuis 1547, et se plaint des piètres possibilités d'échanges
intellectuels et culturels (p.122 cf. supra, & p.220) : "je
suis logé pour la faculte de quoy je fais profession entre bestes
brutes, & gents barbares, ennemys mortelz de bonnes lettres, &
de memorable erudition." César rappelle que les sentiments de Nostradamus envers les salonnais ne s'étaient guère améliorés dix ans plus tard, surtout après les menaces
dont il a été l'objet durant les émeutes paysannes d'avril 1561, ou de mai 1560 selon César qui rapporte les cris alors proférés : "Au feu, au feu, vivent Cabans, meurent
Lutheriens" (786E, Histoire, 1614, p.785-788). Lors du passage de Charles IX à Salon le 17 octobre 1564, Nostradamus aurait souhaité rester à part de la délégation
officielle, et se serait écrié : "O ingrata patria, veluti Abdera Democrito" (Ô Patrie ingrate comme le fut Abdère pour Démocrite).
Voici l'ensemble du témoignage de César se rapportant à cette journée du 17 octobre :
"Bien peu apres vint en Provence le jeune Roy qui faisoit le tour de son Royaume, & arrivé à ceste ville de Sallon le dix-septieme d'Octobre, jour dedié au Dieu
Mars [un mardi], à trois heures apres midy. (...) Anthoine de Cordoüa Gentilhomme honnorable & liberal, qui peu apres fut fait Chevalier de sainct Michel,
& Iaques Paul l'un des plus riches hommes de son temps, lequel pareillement quelques annees apres fut ennobly, estans en charge de // Consuls, le reçeurent
à la porte par où il entra, sous un poisle de damas violet & blanc. Ces deux Magistrats honnorablement accompagnés des plus nobles & apparens
bourgeois de la ville, supplierent bien instamment Michel de Nostradame, personnage le nom duquel suffit assés, de vouloir estre avec eux, & parler à sa Majesté au
poinct de la reception, estimant à l'avanture non en vain, qu'elle auroit un contentement particulier de le voir : mais il s'en excusa autant gracieusement qu'il peut
à de Cordoüa, son singulier & intime amy, & à ses compagnons, leur remonstrant qu'il desiroit faire son train à part, & saluër sa Majesté hors de la tourbe
populaire, & de ceste foule d'hommes, estant tres-bien adverti qu'il seroit requis & demandé, comme il arriva.
Ainsi donc que fort decemment couvert, il attendoit le coup de rendre cest hommage à son Roy, voicy que les Consuls le monstrerent à sa Majesté, à laquelle tout à poinct
il fit une tres-humble & convenable reverence d'une franche & philosophique liberté, prononçant ce vers du Poëte. Vir magnus bello, nulli pietate secundus.
["Grand guerrier, et en piété dépassé par nul autre", ps. Ovide, Argumenta decasticha Aeneidos].
Suyvant, comme tout hors de soy par un aise extraordinaire qu'il sentit à cest instant de se voir tant humainement accueilly d'un tel & si grand Monarque,
duquel il estoit né subject, & comme indign(é) contre sa propre terre ces mesmes paroles : O ingrata patria, veluti Abdera Democrito.
Comme s'il eut voulu dire : ô terre ingratte, à qui je donne quelque nom, voy l'estat que mon Roy daigne encor faire de moy !
Ce qu'il disoit sans doute assez ouvertement en ce peu de mots, contre le rude & incivil traittement que certains seditieux mutins,
gens de sac & de corde, bouchers sanguinaires, & vilains Cabans avoyent faict à luy, qui donnoit tant de gloire à son pays.
Adonc l'accompagna mon pere, car c'est de luy que je parle, tousjours costé à costé, avec son bonnet de velours d'une main,
& un gros & tres-beau jonc marin d'Indie emmanché d'argent de l'autre, pour s'appuyer durant le chemin,
(parce qu'il estoit quelquefois tourmenté de ceste fascheuse douleur de pieds que le vulgaire appelle gouttes) jusques
aux portes du chasteau, & encor dans sa propre chambre, où il entretint fort longuement ce jeune Roy, & la Royne
Regente sa mere, qui eurent ceste humaine curiosité de voir toute sa petite famille, jusques à une fille de laict.
Et de ce me souvient fort bien, car je fus de la partie." (Histoire, 1614, p.801-802).
Faisant allusion aux spectacles de rue et reconstitutions dites historiques qui se déroulent chaque année fin juin à Salon, Maryline Crivello (qui reprend le récit de César d'après un texte corrompu de seconde main) s'interroge sur la légitimité de telles manifestations commémoratives : "Il existe ainsi un réel écart entre ce document [le témoignage de César sur la venue de Charles IX à Salon], fondateur du spectacle, qui exprime nettement à quel point Michel de Notre-Dame était peu intégré à la population salonaise et l'enthousiasme appuyé lors du passage dans le cortège reconstitué de son interprète actuel. Nostradamus n'était pas prophète en son pays, rejeté par les ancêtres de ces Salonais qui désormais, au bénéfice des spectacles, s'en réclament." (Maryline Crivello, "Du passé, faisons un spectacle ! Généalogies des reconstitutions historiques de Salon et Grans en Provence (XIXe-XXe siecles)", in Sociétés & Représentations 12, Revue du CREDHESS, Paris, 2001, p.230). On souhaiterait que la municipalité salonaise et la maison dite de Nostradamus optent pour la recherche et allouent la part culturelle congrue de l'argent du contribuable à la connaissance sérieuse et à la publication des inédits de l'oeuvre de l'astrologue et voyant saint-rémois, plutôt que de satisfaire les instincts populaires par la représentation d'un "Nostradamus festif" totalement anachronique.
Et Stéphane Gerson souligne l'échec de la mascarade salonaise dont l'objectif initial avait été d'instrumentaliser Nostradamus en vue de relancer une dynamique économique locale en déclin : "Nostradamus devint le centre absent de Salon : ses habitants ne pouvaient y échapper tandis que les visiteurs recherchaient en vain le sinistre prophète." Des entrepreneurs en aménagement culturel, pour la plupart des locaux hostiles au prophète astrologue, tentèrent d'en forger une image controuvée et biaisée "mêlant réinvention et effacement, emprunts et réappropriations, refus incertains et détournements." ("Le patrimoine local impossible : Nostradamus à Salon-de-Provence (1980-1999)", in Genèses, 92, 2013, p.71). Gerson s'en tient prudemment (ou lâchement) aux années 1980-2000 sans prolonger le constat jusqu'à la dizaine d'années précédant la publication de son article !
Outre Salon, quinze villes sont mentionnées : La Rochelle (p.155),
Bordeaux (pp.110, 155 &.218), Agen (pp.12 & 218), Toulouse (pp.155
& 218), Carcassonne (p.218), Narbonne (p.218), Montpellier (p.217),
Lyon (p.216), Vienne (p.219), Valence (p.219), Avignon (p.176), Aix (pp.50
& 101), Marseille (pp.101 & 216), Savone (pp.122, 216 & 202),
et Gênes (p.59). Hormis La Rochelle, plus au nord, Aix, Marseille,
et les deux villes de la côte italienne, elles sont toutes situées
le long de la Garonne, de l'actuel canal du Midi, imaginé et commencé
par le salonais Adam de Craponne, et du Rhône jusqu'à Lyon.
Elles se situent sur un tracé formant un arc de cercle évasé,
de Lyon à La Rochelle en passant par Narbonne. Un second arc de
cercle longeant la côte méditerranéenne coupe le premier
à Avignon. Ces deux tracés forment une sorte de n inversé.

Une centaine d'auteurs, de connaissances et de personnages historiques
ou légendaires sont mentionnés, comme Euphorbe (p.217) ou
le devin Tirésias (p.105) : voir les tableaux ci-dessous, par domaines
d'activité, et par noms. D'autres, qu'on pourrait attendre, n'apparaissent
pas, comme Ptolémée, Horapollon (dont Nostradamus entreprend
la traduction des Hieroglyphica en 1541), Albumasar, Léonard
de Vinci, Copernic, Paracelse, Pierre Turrel, Richard Roussat, ou encore
Rabelais, immatriculé à la faculté de médecine
un an après Nostradamus, et dont les ouvrages avaient déjà
connu un grand retentissement. Les médecins d'une part, et les érudits,
philologues et historiens de l'autre, comptent pour la moitié des
personnes mentionnées. Aucun astrologue. Les théologiens
et idéologues chrétiens sont ignorés. Le Christ lui-même
n'est mentionné que deux fois, et le sont aussi Mahomet et le prophète
et réformateur iranien Zoroastre, encore que ce nom pourrait ne
recouvrir que l'un des nombreux ouvrages apocryphes qui lui ont été
attribués.
|
Activité
|
Nom |
|
Pages |
|
empereur
|
Auguste |
G-R |
109 |
|
empereur
|
Gordien |
G-R |
103 |
|
empereur
|
Hadrien |
G-R |
71 |
|
empereur
|
Nerva |
G-R |
71 |
|
empereur
|
Trajan |
G-R |
71 |
|
roi
|
François
1er |
mod |
176 |
|
gouvernant
|
Maistre de Rhodes |
mod |
176 |
|
militaire
|
Alcibiade |
G-R |
22 |
|
militaire
|
Drusus |
G-R |
109 |
|
avocat
|
Jean Treilles |
mod |
111 |
|
juriste
|
Pierre Cara |
mod |
201, 223 |
|
ecclésiastique
|
Ammanien de
Foix |
mod |
92 |
|
ecclésiastique
|
Cardinal de
Clermont |
mod |
176 |
|
prophète
|
Mahomet |
Ara |
162 |
|
prophète
|
Jésus
Christ |
G-R |
103, 217 |
|
prophète
|
Zoroastre |
Ira |
114 |
|
médecin
|
al-Zahrawi (Bulchasis,
Albucasis) |
Ara |
205, 210 |
|
médecin
|
Paulus Aegineta |
Byz |
3 |
|
médecin
|
Andromachus |
G-R |
52 |
|
médecin
|
Asclépiade
(Asclapon) |
G-R |
109 |
|
médecin
|
Cornelius Celsius |
G-R |
10 |
|
médecin
|
Dioscoride |
G-R |
122, 217 |
|
médecin
|
Erasistrate |
G-R |
112, 217 |
|
médecin
|
Galien |
G-R |
12, 13, 13,
219 |
|
médecin
|
Hippocrate |
G-R |
12, 15, 27,
101, 217 |
|
médecin
|
Antonius Saporta,
de Montpellier |
mod |
217 |
|
médecin
|
Franciscus Marius,
de Vienne |
mod |
220 |
|
médecin
|
François
Valeriola |
mod |
12, 220 |
|
médecin
|
Guillaume Rondelet |
mod |
217 |
|
médecin
|
Hieronymus Massarius |
mod |
115, 217 |
|
médecin
|
Hieronymus Montuus,
de Vienne |
mod |
219 |
|
médecin
|
Honorius Du
Chastel (Castellanus) |
mod |
217 |
|
médecin
|
Jacques Dubois
Sylvius |
mod |
13 |
|
médecin
|
Joseph Turel
Mercurin, d'Aix |
mod |
101, 216 |
|
médecin
|
Leonhart Fuchs |
mod |
13 |
|
médecin
|
Louis Serre |
mod |
101, 216 |
|
médecin
|
Philibert Sarrazin |
mod |
219 |
|
apothicaire
|
Antonio Vigerchio |
mod |
216 |
|
apothicaire
|
François
Bérard |
mod |
101, 166, 216 |
|
apothicaire
|
Leonard Bandon |
mod |
110 |
|
poète
|
Apulée |
G-R |
71 |
|
poète
|
Archiloque |
G-R |
17, 110 |
|
poète
|
Ausone |
G-R |
105 |
|
poète
|
Héliodore |
G-R |
20 |
|
poète
|
Homère |
G-R |
218 |
|
poète
|
Lucien |
G-R |
100 |
|
poète
|
Lucilius |
G-R |
17, 18, 20 |
|
poète
|
Posidippus |
G-R |
21 |
|
poète
|
Clément
Marot |
mod |
219 |
|
peintre
|
Zeuxis d'Héraclée |
G-R |
57 |
|
sculpteur
|
Lysippus |
G-R |
21 |
|
sculpteur
|
Myron |
G-R |
105 |
|
historien
|
Bérose |
G-R |
114 |
|
historien
|
César |
G-R |
11 |
|
historien
|
Diodore de Sicile |
G-R |
16 |
|
historien
|
Hérodote |
G-R |
16, 59 |
|
historien
|
Agathius Scholasticus |
Byz |
18 |
|
érudit
|
Archimède |
G-R |
219 |
|
érudit
|
Athénée |
G-R |
224 |
|
érudit
|
Cicéron |
G-R |
10, 109, 219 |
|
érudit
|
Elien (Aelianus) |
G-R |
115, 217 |
|
érudit
|
Macrobe |
G-R |
224 |
|
érudit
|
Marc Varron |
G-R |
7, 12, 131,
146, 147 |
|
érudit
|
Pline |
G-R |
10, 115 |
|
érudit
|
Plutarque |
G-R |
12 |
|
érudit
|
Alde (Aldus
Manutius) |
mod |
10 |
|
érudit
|
Ambrosius Leo
Nolanus |
mod |
10 |
|
érudit
|
Christophorus
Marsupinus |
mod |
22 |
|
érudit
|
Erasme |
mod |
10 |
|
érudit
|
Ficin |
mod |
12, 22 |
|
érudit
|
Hermolaus Barbarus |
mod |
201, 202, 204,
223 |
|
érudit
|
Longolius |
mod |
10 |
|
érudit
|
Marcus Musurus |
mod |
10 |
|
érudit
|
Nicolaus Leonicenus |
mod |
11 |
|
érudit
|
Scaliger |
mod |
12, 218 |
|
philosophe
|
Aristippe |
G-R |
219 |
|
philosophe
|
Aristote |
G-R |
115 |
|
philosophe
|
Chrysippe |
G-R |
14 |
|
philosophe
|
Lucrèce |
G-R |
22, 69, 71 |
|
philosophe
|
Platon |
G-R |
8, 12, 22, 74,
115 |
|
philosophe
|
Pythagore |
G-R |
10, 114, 228 |
|
philosophe
|
Socrate |
G-R |
70 |
| |
Bernardo Grasso
(Savone) |
mod |
122 |
| |
Carolus Seninus
(Bordeaux) |
mod |
111 |
| |
Jean Ferlin
(Savone) |
mod |
122 |
| |
Johannes Tarraga
(Bordeaux) |
mod |
111 |
| |
René
Le Pillier Verd (Lyon) |
mod |
216 |
Plus de la moitié de ces auteurs appartiennent à la culture
classique gréco-romaine ; les autres sont des modernes ou des contemporains,
à l'exception du poète et historien byzantin Agathius Scholasticus
(ca. 536-582), du médecin byzantin Paulus Aegineta (625-690), apprécié
de Nostradamus, du médecin et chirurgien andalou al-Zahrawi, décédé
en 1013, et des deux prophètes mentionnés.
| Nom |
Activité |
Pages |
| Agathius Scholasticus |
historien |
18 |
| Alcibiade |
militaire |
22 |
| al-Zahrawi (Bulchasis,
Albucasis) |
médecin |
205, 210 |
| Andromachus |
médecin |
52 |
| Apulée |
poète |
71 |
| Archiloque |
poète |
17, 110 |
| Archimède |
physicien |
219 |
| Aristippe |
philosophe |
219 |
| Aristote |
philosophe |
115 |
| Asclépiade
(Asclapon) |
médecin |
109 |
| Athénée |
érudit |
224 |
| Auguste |
empereur |
109 |
| Ausone |
poète |
105 |
| Bérose |
historien |
114 |
| César |
historien |
11 |
| Chrysippe |
philosophe |
14 |
| Cicéron |
érudit |
10, 109, 219 |
| Cornelius Celsius |
médecin |
10 |
| Diodore de Sicile |
historien |
16 |
| Dioscoride |
médecin |
122, 217 |
| Drusus |
militaire |
109 |
| Elien (Aelianus) |
érudit |
115, 217 |
| Erasistrate |
médecin |
112, 217 |
| Galien |
médecin |
12, 13, 13,
219 |
| Gordien |
empereur |
103 |
| Hadrien |
empereur |
71 |
| Héliodore |
poète |
20 |
| Hérodote |
historien |
16, 59 |
| Hippocrate |
médecin |
12, 15, 27,
101, 217 |
| Homère |
poète |
218 |
| Jésus
Christ |
prophète |
103, 217 |
| Lucien |
poète |
100 |
| Lucilius |
poète |
17, 18, 20 |
| Lucrèce |
philosophe |
22, 69, 71 |
| Lysippus |
sculpteur |
21 |
| Macrobe |
érudit |
224 |
| Mahomet |
prophète |
162 |
| Myron |
sculpteur |
105 |
| Nerva |
empereur |
71 |
| Paulus Aegineta |
médecin |
3 |
| Platon |
philosophe |
8, 12, 22, 74,
115 |
| Pline |
érudit |
10, 115 |
| Plutarque |
érudit |
12 |
| Posidippus |
poète |
21 |
| Pythagore |
philosophe |
10, 114, 228 |
| Socrate |
philosophe |
70 |
| Trajan |
empereur |
71 |
| Varron |
érudit |
7, 12, 131,
146, 147 |
| Zeuxis d'Héraclée |
peintre |
57 |
| Zoroastre |
prophète |
114 |
| |
|
|
| Alde Manuce
(Aldus Manutius) |
érudit |
10 |
| Ambrosius Leo
Nolanus |
érudit |
10 |
| Ammanien de
Foix |
ecclésiastique |
92 |
| Antonio Vigerchio |
apothicaire |
216 |
| Antonius Saporta,
de Montpellier |
médecin |
217 |
| Bernardo Grasso
(Savone) |
|
122 |
| Cardinal de
Clermont |
ecclésiastique |
176 |
| Carolus Seninus
(Bordeaux) |
|
111 |
| Christophorus
Marsupinus |
érudit |
22 |
| Clément
Marot |
poète |
219 |
| Didier Erasme |
érudit |
10 |
| Franciscus Marius,
de Vienne |
médecin |
220 |
| François
1er |
roi |
176 |
| François
Bérard |
apothicaire |
101, 166, 216 |
| François
Valeriola |
médecin |
12, 220 |
| Gisbert Longolius |
érudit |
10 |
| Guillaume Rondelet |
médecin |
217 |
| Hermolaus Barbarus |
érudit |
201, 202, 204,
223 |
| Hieronymus Massarius |
médecin |
115, 217 |
| Hieronymus Montuus,
de Vienne |
médecin |
219 |
| Honorius Du
Chastel (Castellanus) |
médecin |
217 |
| Jacques Dubois
Sylvius |
médecin |
13 |
| Jean Ferlin
(Savone) |
|
122 |
| Jean Treilles |
avocat |
111 |
| Johannes Tarraga
(Bordeaux) |
|
111 |
| Joseph Turel
Mercurin, d'Aix |
médecin |
101, 216 |
| Jules César
Scaliger |
érudit |
12, 218 |
| Leonard Bandon |
apothicaire |
110 |
| Leonhart Fuchs |
médecin |
13 |
| Louis Serre |
médecin |
101, 216 |
| Maistre de Rhodes |
gouvernant |
176 |
| Marcus Musurus |
érudit |
10 |
| Marsile Ficin |
érudit |
12, 22 |
| Nicolaus Leonicenus |
érudit |
11 |
| Philibert Sarrazin |
médecin |
219 |
| Pierre Cara |
juriste |
201, 223 |
| René
Le Pillier Verd (Lyon) |
|
216 |
Retenons quelques noms, parmi d'autres : le poète grec Posidippus
(Poseidippos) (c. 280-240), le célèbre médecin grec
épicurien Asclépiade (c.124-40), et le compilateur romain
de langue grecque Claudius Aelianus (Elien) dit le Sophiste (fl. 215-250),
auteur d'une Histoire des Animaux et d'Histoires variées
(compilation d'anecdotes historiques et de faits divers), ouvrages qui
ont vraisembablement inspiré l'auteur des Prophéties.
Et parmi les humanistes modernes :
- Ermolao Barbaro (1453-1493), philosophe, philologue et helléniste
vénitien, universitaire à Padoue, commentateur d'Aristote
et de Dioscoride, éditeur et correcteur du texte de Pline, les Castigationes
Plinianae et in Pompontum Melam (Rome, 1492-93 ; éd. Giovanni Pozzi, Padoue, 1973-79). Il serait
mort de la peste à Rome. Le sémioticien américain
Charles Peirce le mentionne (cf. ses Collected papers, 5.299) et
on connaît une lettre que lui adresse Pico, "Sur le style des philosophes",
datée du 3 juin 1485 (in Jean Pic de la Mirandole, Oeuvres philosophiques,
éd.-trad. Olivier Boulnois & Giuseppe Tognon, Paris, PUF, 1993, p.255-266).
- Marcus Musurus (c. 1470-1517), helléniste et collaborateur
de l'imprimeur vénitien Alde
- Jacques Dubois dit Sylvius (1478-1555), anatomiste français,
pionnier de la dissection
- Gisbert Longolius (1507-1543), correspondant de Bembo
- Leonard Fuchs (1501-1566) célèbre médecin et
botaniste bavarois, dont le nom a été donné au Fuchsia,
découvert à la fin du XVIIe siècle
On pourra consulter des ouvrages de la plupart des médecins mentionnés
sur le site de la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM biuSanté).
Parmi ceux qui deviendront les correspondants de Nostradamus et dont
les lettres ont été conservées, seul figure le pharmacien
salonais François Bérard, et parmi la vingtaine de médecins
mentionnés exerçant l'art iatrice (du grec iatrós, médecin), près de
la moitié d'entre eux se sont inscrits à la faculté
de Montpellier dont Nostradamus appréciait l'enseignement malgré
les quelques déboires qu'il a connus à son arrivée
: Louis Serre de Marseille en 1507, François Valeriola en 1514,
Hieronymus Montuus (Jérôme de Monteux) en 1518, Antonius Saporta
en 1521, Guillaume Rondelet et Jacques Dubois Sylvius en 1529 (la même
année que Nostradamus), Philibert Sarrazin en 1539, Honoré
Du Chastel en 1544 ... (sur ces médecins, cf. Gouron, 1957 & Saulnier, 1957).
5. Le système de codage du TFC dans l'édition de 1555
Ce texte fait suite à mes précédentes études
sur le codage numérologique du Testament (1566, cf. CN 177) et
de l'Orus (1541, cf. CN 19), qui
est la traduction manuscrite des Hiéroglyphes d'Horapollon.
Le TFC se rattache au manuscrit de l'Orus par divers
indicateurs : "en Arabie la felice" [p.59], expression traduite
du grec mais néanmoins usuelle à l'époque, et surtout
"la hyene, cynocephale, & crocodille, & hippopotame" [p.116],
quatre animaux dont les hiéroglyphes sont explicités dans
le manuscrit, introduit par un prologue de 116 vers décasyllabiques.
Il est possible que toutes les corrélations explicitées
ci-après n'aient pas toutes été intentionnelles :
cependant le grand nombre de coïncidences repérées à
partir des mêmes méthodes que pour les précédents
textes, confirme l'existence d'un codage. En outre je n'ai pas totalement
exploré les possibilités du TFC, à la structure très
complexe, et il se pourrait qu'une "seconde clé" cryptographique
(que je n'ai pas trouvée et qui pourrait avoir rapport au nombre
d'or et à la suite de Fibonacci, puisque les nombres 5, 8, 13, 34
et 89 sont apparents : cf. infra), ait été mise en
place avec ce traité, en plus de celle confirmant le nombre de quatrains
du corpus. Le format de l'ouvrage, à savoir environ 12 cms de haut
pour 7,5 cms de large (118 x 75 pour l'exemplaire de Lyon), respecte les
proportions du nombre d'or.
Le TFC comprend 240 pages dont 228 sont numérotées :
p.1 : titre : 1 page
p.2 : blanc
p.3 : épître au lecteur (Prooeme) : 22 pages + lettrine A
p.25 : première partie (Préparations
cosmétiques) : 100 pages + lettrine P
p.125 : épître à Jean de Nostredame (Prooeme) :
8 pages + lettrine P
p.133 : seconde partie (Recettes culinaires)
: 89 pages + lettrine V
(au chapitre 28, p.205, lettrine C)
p.222 : hexastichum (Sizain) : 1 page
p.223 : lettre d'Hermolaus Barbarus à Pierre Cara : 6 pages
+ lettrine L
[p.229] : table (non paginée) : 11 pages
[p.240] : blanc
|
Chapitres |
Décomposition |
Pages |
Décomposition |
| Épître I |
1 |
|
22 |
11 x 2 |
| Livre I |
34 |
15 + 19 |
100 |
|
| Épître II |
1 |
|
8 |
|
| Livre II |
30 [ou 31] |
(15 x 2) = (11 + 19) |
89 |
100 - 11 |
| Annexe |
1 |
|
6 |
|
| Table |
1 |
|
11 |
|
| Total paginé/numéroté |
64 |
8 x 8 |
228 |
19 x 2 x 6 |
| Total réel |
65 |
5 x 13 |
240 |
15 x 2 x 8 |
Les nombres pilotes de ce dispositif sont 11, 15 et 19. Les autres
nombres, 2, 6 et 8, sont des nombres codants intermédiaires. Le
multiplicateur 2 se justifie en raison de la division du traité
en 2 parties, comme dans l'Orus. Les nombres 6 et 8 sont rappelés
dans le traité par la présence de deux pièces versifiées
: un huitain traduit de Lucilius (à la page 19), et une épigramme
de six vers en hommage à l'auteur (à la page 222).
Les deux parties du traité totalisent 64 chapitres numérotés,
correspondant aux 34 préparations cosmétiques de la première partie et aux 30 recettes culinaires
de la seconde. Curieusement cette organisation rappelle celle du principal
traité divinatoire de la littérature mondiale, à savoir
le Yi King chinois, également divisé en deux parties
de 30 et de 34 chapitres, chacun d'eux traitant d'un hexagramme qui illustre
une situation possible de la vie intérieure. Les voyages de Marco
Polo datent de la fin du XIIIe siècle, et il
se peut que Nostradamus, qui aimait l'Italie comme la plupart des humanistes
de son siècle et des siècles suivants, ait eu accès
à certains documents relatifs au Yi King, lesquels ont véritablement
commencé à circuler dans les cercles érudits à
partir du XVIIe siècle. On connaît l'intérêt
de Leibniz pour le Livre des Transformations.
En réalité le TFC comprend 65 chapitres (recensés
dans la table), soit 34 dans la première partie et 31 dans la seconde
: n'est pas numéroté le chapitre "7 bis" de la seconde partie,
en réalité le huitième : "La façon pour
clarifier la cassonade, ou le succre qui est noir, ou gasté tant
pour la presente confiture, que pour toutes autres". Aux pages 151-152-153
du traité (à rapprocher avec la date de sa composition, à
savoir 1552), ce chapitre général, puisqu'il traite du sucre
lui-même, ingrédient de base de la plupart des préparations,
serait en fait le chapitre 41 bis, indiquant une affiliation avec l'Orus
de 1541, rédigé précisément 11 ans avant le
TFC, et par conséquent la continuation du codage.
La pagination du texte et les nombres 11, 15 et 19
Nous avons déjà eu l'occasion de constater que les années
de composition des ouvrages n'étaient pas laissées au hasard,
et que le double de ces années, pour l'Orus et pour les Prophéties,
était significatif. De même pour le TFC : le double de l'année
1552, à savoir 2114, doit se lire 2 fois 114 (= 228) et indique
le nombre de pages du traité, hormis la table, non paginée.
Un grand soin a été apporté à la mise en
page du traité, au contraire de l'orthographe et de la syntaxe du
texte. Or la page 191 est numérotée 19, et le chapitre 19
de la première partie "n'existe pas" et est numéroté
20 comme le suivant, ainsi que le chapitre 11 de la seconde partie, numéroté
12. Ce qui autorise à relier ces nombres selon la formule (11 +
19) = 30 (qui est le nombre de chapitres numérotés de la
partie culinaire) = (15 x 2), et au nombre de quatrains du corpus : 1130
= (100 x 11) + (11 + 19), ou encore 1130 = (100 x 11) + (15 x 2).
Les nombres 19 et 15 (ou encore leur somme valant 34, qui est le nombre
de chapitres de la partie cosmétique) sont à rajouter aux
942 quatrains des Prophéties et aux 154 quatrains des Almanachs,
ce qui confirme les résultats de mes articles précédents.
Le nombre 15 est encore souligné dans le nombre de villes mentionnées
par le médecin itinérant, dans la description du banquet
donné par l'italien Trivulcius en 1488 : Ermolao Barbaro énumère
les 15 mets qui se succèdent, et mentionne l'écrivain grec
Athénée (IIe siècle), lequel a composé son
Dipnosophistarum (Le banquet des érudits) en 15 livres, ouvrage
édité à Venise en 1514 et à Bâle en 1535.
On notera encore que 64 ans (1552 - 1488), qui est le nombre de chapitres
du TFC, plus 1 mois et 5 jours (équivalents ici à 15 ?),
séparent la date de la lettre de Barbaro de celle de la composition
du TFC.
L'interprétation numérologique des relations entre les
nombres 11, 15 et 19 d'une part, et les nombres de chapitres 30
et 34 d'autre part, est donc triviale : il manquerait 34 quatrains
(à savoir 15 + 19) aux 1096 quatrains imprimés (942
dans les Prophéties, et 154 dans les Almanachs) pour
atteindre le total des 1130 quatrains de l'oeuvre prophétique
La leçon des lettrines
Cinq ou six lettrines, de très belle facture, introduisent les
deux épîtres, les deux parties du traité, la lettre
de Barbaro, et le chapitre 28 du second traité : 6 lettrines au
total, mais 5 grandes et une plus petite (la lettrine C), et 5 différentes
et une redoublée, la lettrine P, comme pour souligner ces nombres
5 et 6. La lettrine C, à la page 205 (= 5 x 41) est un marqueur
intermédiaire qui souligne une fois de plus la relation à
l'Orus (composé en 1541).
En outre la position de ces lettrines dans le texte et les pages qui
leur correspondent semblent obéir à un dispositif intentionnel
: lettrine A à la page 3, lettrine P à la page 25, autre
lettrine P à la page 125, lettrine V à la page 133, lettrine
L à la page 223.
La lettrine A se situe à la page 3, de la lettrine A à
la lettrine P on compte 22 pages, de la lettrine A à la lettrine
V 130 pages (= 13 x 10), de la lettrine A à la lettrine L 220 pages
(= 22 x 10), et de la première lettrine P à la seconde, on
compte 100 pages (= 10 x 10).
Outre la dizaine (10), on retrouve les nombres principaux du Testament,
à savoir 3, 13 et 22. On a aussi les relations (22 - 3) = 19 et
(22 + 13 + 10) / 3 = 15, et par suite les relations triviales, car en rapport
à la fois avec les nombres précédents et le nombre
de lettrines (5 ou 6) :
13 + 6 = 19
10 + 5 = 15
Ces sommes, correspondant à 4 suppléments, indiquent les
groupements de quatrains supplémentaires à ajouter aux 1096
quatrains connus des Prophéties et des Almanachs.
Le supplément du Janus de Chavigny (les 13 quatrains des
"centuries" XI et XII) correspond vraisemblablement au premier de ces nombres.
Un second supplément pourrait recouvrir les 10/11 quatrains transmis
par François Gallaup de Chasteuil (ms 386 de la bibliothèque
Inguimbertine de Carpentras ; cf. mon texte "Les 34 quatrains
supplémentaires de l'oeuvre prophétique", CURA, à
paraître).
La leçon des épigrammes
Les deux épigrammes du traité, l'une de 8 vers et traduite
du grec de Lucilius (pp.125-132), l'autre de 6 vers et adressée
à Nostradamus (pp.223-228) occupent dans le traité un emplacement
qui peut paraître significatif. En effet :
La somme des pages 125 à 132, soit 1028, vaut aussi [(4 x 289)
+ (3 x 300)] / 2
La somme des pages 223 à 228, soit 1353, vaut encore 1000 +
353
Et 353, 289 et 300 sont les nombres de nouveaux quatrains publiés
dans les différentes éditions des Prophéties
: celle de Macé Bonhomme en 1555, celles d'Antoine du Rosne en 1557 et 1558.
Credis sum Pythiovera magis tripode
La traduction de cette sentence n'est pas aisée, et le néologisme Pythiovera devrait compter deux mots
: Pythio vera, "semblable à Apollon Pythien", ce qui réduit à 5 les 6 mots de la sentence (à mettre en parallèle avec le nombre de lettrines). On
peut avancer la traduction suivante : "Je suis, tu le crois, comme Apollon Pythien (et) les sorciers à trépied", ou celle-ci, avec magis adverbial :
"Le crois-tu, je suis une Pythie plus sincère qu'un oracle", ou encore "Tu le crois car ma parole est plus fiable que celle issue du trépied pythien."
Claude Lecouteux, dans l'adaptation Kosta-Théfaine du Traité des Confitures (oct. 2010, p.127), propose la traduction suivante : "Fie-toi à moi qui suis la
véritable Pythonisse au trépied magique", et Denis Crouzet traduit Nostradamus comme se disant "possesseur de vérités plus vraies encore que celles proférées à partir
du trépied pythique" (2011, p.158).
Nostradamus a probablement trouvé sa formule dans les Inscriptiones sacrosanctae d'Apianus
et Amantius (cf. aussi CN 10, 28, 61, 68, 130 et 194), qui donnent pour cette inscription romaine Pythio vera en deux mots et le
pluriel sunt auquel Nostradamus substitue "sum" : Credis, sunt Pythio vera magis Tripode (Inscriptiones sacrosanctae, Ingolstadt, 1534, p.239). Une
traduction partielle de l'inscription (de Semicapri à Tripode) figure aux Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi
de la Belgique (vol. 1, Valenciennes, 1829, p.394) :
"Qui que tu sois qui entre dans le sanctuaire du dieu Faune aux pieds de chèvre,
tu liras cette inscription d'origine romaine.
Cy gît Hersilus : avec lui repose Marulla,
à la fois sa mère, sa soeur et son épouse.
Tu doutes, lecteur, tu fronces le sourcil,
tu vois dans ces paroles une énigme proposée aux Sphinx futurs :
elles sont pourtant plus vraies que les oracles Pythiens."

Cette formule tout-à-fait surprenante à la fin du livre
des confitures montre que Nostradamus a d'autres objectifs que la seule
publication de recettes : une formule de 30 ou 31 lettres (30 selon l'alphabet
grec avec un thêta, ou 31 selon l'alphabet latin), qui rappelle
les 30 ou 31 chapitres de ce second livre, avec 15 lettres utilisées
: A C D E G H I M O P R S T U Y.
Imaginons l'inscription des lettres de cette formule, deux fois sur
l'espace d'un trépied, auxquelles seront ajoutées deux lettres
justifiant la double-inscription et parce que la formule apparaît
dans le second livre du traité :
|
credis
|
sum
|
Pythiovera
|
magis
|
tripode
|
|
credis
|
sum
|
Pythiovera
|
magis
|
tripode
|
| |
|
M N
|
|
|
ou encore, en remplaçant les lettres par leurs nombres associés
et en décalant deux des termes centraux afin d'obtenir l'image d'un
trépied :
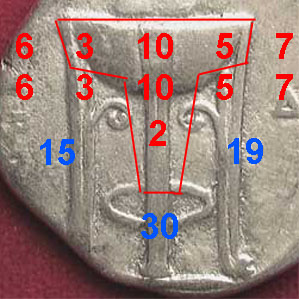
On obtient à nouveau les nombres 15 (1e colonne), 30 (colonnes
centrales), 19 (dernière colonne), 11 (nombres utilisés),
et 64 (total de tous les nombres). En conclusion, j'ai le sentiment d'avoir effectué un premier déchiffrement
d'un texte qui recèle probablement d'autres mystères...
Retour à l'index
Bibliographie
Retour Nostradamica
Accueil CURA
Patrice Guinard: Excellent & moult utile Opuscule
(Analyse du Traité des Fardements et des Confitures)
http://cura.free.fr/dico3/604B-TFC-edc.html
19-04-2006 ; last updated 10-03-2020
© 2006-2020 Patrice Guinard
|